Explication linéaire Les fenêtres de Charles Baudelaire
0 (0 avis)
6.80€ | 0 consultation(s) | 5 page(s)

Présentation du document :
Charles Baudelaire, "Les fenêtres", Petits poèmes en prose explication linéaire à télécharger.
Description du document :
Question : Ce poème ne dépasse-t-il pas la simple description picturale d'un objet du quotidien ?
Extrait de l'explication :
« La poésie est comme une peinture » (Horace, poète latin), qui travaille sur les lumières et les contrastes (« ténébreux » / « éclairée, chandelle » : sorte de clair-obscur). Baudelaire plaide implicitement pour une poésie du quotidien et du réel : pour lui, c'est l'observation qui est source de création. À travers l'énumération de réalités simples, il privilégie le quotidien (« presque rien »), mais esthétisé par la mention de la « chandelle », plus poétique que l'éclairage au gaz de l'époque
[...]
La fenêtre prend une valeur symbolique et donne au poème une portée philosophique. Elle est pour Baudelaire :
- un moyen de corriger notre conception habituelle du monde : une fenêtre fermée est plus intéressante qu'une fenêtre ouverte ;
- un moyen de passer de l'extérieur de la réalité à une réalité intérieure, celle de la condition humaine, du mystère des êtres ;
- un moyen de mieux se connaître, de lutter contre le spleen : cette fenêtre, paradoxalement, ouvre aussi sur le monde intérieur du poète, sur son identité (« sentir que je suis et ce que je suis »).
[...]
Les fenêtres » donne du poète une image moins pessimiste que les poèmes du spleen, mal de vivre dévastateur. Ici, le poète est attentif à la misère des autres dans laquelle il trouve un aliment pour sa création mais aussi une force pour mieux se connaître et mieux « vivre » : il se dit « fier », il a été « aidé » par cette expérience. De cette expérience du regard, de ce partage – même lointain – du malheur des autres, il reste un objet poétique, une trace tangible : le poème.
Deux autres poètes après Baudelaire choisiront les fenêtres comme sujet poétique : Mallarmé et Apollinaire, comme l'ont fait de nombreux peintres (Vermeer, Van Gogh, Matisse…).
Sommaire du document :
- Préparation
- Présentation
Introduction
I. Un poème construit comme un tableau
II. Un art poétique et une réflexion sur la condition humaine
Conclusion
FAQs
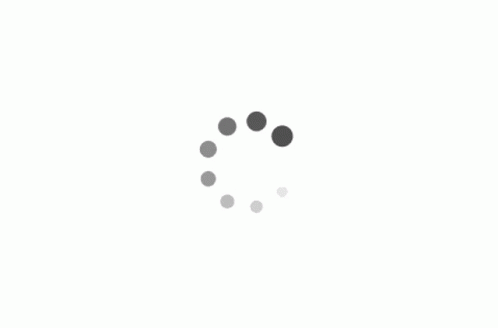
Liste des avis
Aucun avis client pour le moment
Derniers documents dans la catégorie
Fiche de révision oral de culture général HEC
Fiche de révision de culture générale spécialement conçue pour l'oral de HEC ! Un concentré d'idées percutantes et d'arguments solides pour brille ...


Explication linéaire Les fenêtres de Charles Baudelaire
Charles Baudelaire, "Les fenêtres", Petits poèmes en prose explication linéaire à télécharger. ...

Fiche récapitulative des révisions de l’EAF : Epreuve écrite
Fiche récapitulative des révisions de l’EAF (Epreuve Anticipée de Français) : Epreuve écrite à télécharger. ...

Fiches révision Histoire concours commun IEP programme complet
Ayant eu le concours commun je partage les fiches que j'ai réalisé grâce à ma prépa IEP (Instituts d'Études Politiques) et du livre officiel programme du ...



Fiche Bac SES : Quels sont les Fondements du Commerce International et de l’Internationalisation de la Production ?
BAC SES : Quels sont les Fondements du Commerce International et de l’Internationalisation de la Production? Fiche de révision à téélcharger ...

Economie : Technique et gestion des organisations
Cours sur la circulation des biens et des services dans les organisations de l'économie(technique de gestion et organisation) ...
