Dissertation La Fontaine - « Il n’y a point de bonne poésie sans harmonie. »
0 (0 avis)
9.90€ | 0 consultation(s) | 5 page(s)

Présentation du document :
Dissertation de prépa Lettres sur l'harmonie poétique, d'après La Fontaine. Plan en 2 parties/3 sous-parties, intro + conclusion. Corrigé à télécharger
Description du document :
[u]Extrait de la dissertation [/u]:
Le type du vers parfait communément admis est celui du vers racinien : équilibré, rythmé, fluide, tombant toujours juste, d’aucuns le considèrent comme parfait. Un autre canon est celui du vers dont les formes, les couleurs, les sons et les évocations sont en correspondances les uns avec les autres, formant ainsi un ensemble fini, un poème ciselé, poli, où chaque élément trouve sa correspondance, et ces deux éléments avec le tout, dans un assemblage de structures et d’images équilibré qui constitue une unité parfaitement lisse et sphérique. La Fontaine tranche : « Il n’y a point de bonne poésie sans harmonie. » Le vers racinien s’inclinerait devant le vers harmonieux, car le vers racinien est une droite régulière lancée vers l’infini, et le poème harmonieux une sphère sans aspérité, parfaitement finie, maîtrisée et close sur elle-même. Toutefois la poésie n’est pas accoutumée à se satisfaire d’elle-même, à se maintenir sous une forme précise et à multiplier les exemplaires de son harmonie. Bien au contraire, elle évolue sans cesse, elle progresse, elle tâtonne, elle suit un itinéraire, pour se trouver elle-même, comme pour trouver l’objet de son désir inassouvi. La poésie ressemble alors davantage à une ligne qu’à une sphère. Si la poésie est le moyen de renouer avec l’harmonie de l’Univers, alors l’harmonie de la poésie, l’harmonie dans la poésie, n’est peut-être pas le moyen, mais le but de sa quête, de notre quête. Nous analyserons en premier lieu l’expression de « bonne poésie », puis nous tenterons de concilier l’idéal de l’harmonie avec le but de la poésie ainsi dégagé.
Auteur : Florian V. (13 notes)

Diplômé d'un BAC+5 en marketing et communication, actuellement directeur marketing pour un site ecommerce français.
Sommaire du document :
Introduction
[b]I) L’expression de « bonne poésie »[/b]
A. le vers de La Fontaine
B. la quête de l'harmonie
C. poésie et cosmos
[b]II) Conciliation entre l’idéal de l’harmonie avec le but de la poésie[/b]
A. les limites de l'harmonie
B. le désir poétique
C. l'impasse du poème
Conclusion
FAQs
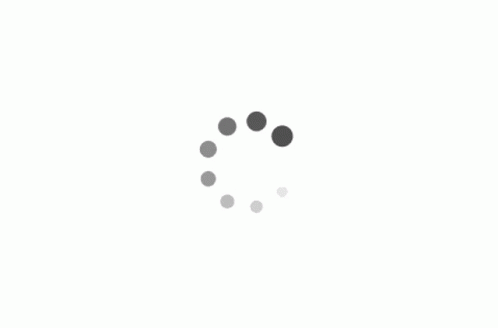
Liste des avis
Aucun avis client pour le moment
Derniers documents dans la catégorie
Essai sur le langage et les œuvres théâtrales de Musset
Ce document est un court essai sur le langage et les œuvres théâtrales de Musset : Les Caprices de Marianne et On ne badine pas avec l’amour. L’intitulé ...

Commentaire de texte - L’Education sentimentale de Gustave Flaubert
Commentaire de texte à télécharger sur L’Education sentimentale de Gustave Flaubert. Document pdf, odt ou docx. ...


L'ironie de la religion dans l'oeuvre d'André Gide, La Symphonie Pastorale.
Mémoire de recherche autour de l'œuvre d'André Gide " La symphonie pastorale". Mémoire à télécharger. ...



Commentaire de texte Bel Ami de Maupassant
Analyse comparative du premier et du dernier chapitre de Bel Ami. Commentaire construit de chacun des chapitres et mise en parallèle. Commentaire de texte à t ...

Commentaire de Rimbaud Le dormeur du Val
Commentaire du "Dormeur du val" de Rimbaud avec introduction , deux grandes parties et une conclusion. Commentaire et analyse complète à télécharger. ...

Commentaire de l'incipit de Voltaire CANDIDE
Commentaire de l'incipit de Voltaire, Candide avec introduction , deux grande parties et une conclusion. ...
