L'Etat est-il l'ennemi de la liberté ? Corrigé dissertation
0 (0 avis)
9.90€ | 0 consultation(s) | 13 page(s)


 Professeur
Professeur
Présentation du document :
Dissertation de philo sur les thèmes de la liberté et de l'état dont la problématique est L'Etat est-il l'ennemi de la liberté ? Dissertation corrigée eu format pdf, docx et odt à télécharger.
Description du document :
Problématique : L'Etat est-il l'ennemi de la liberté ?
Cette problématique peut être formulée de différentes matière également mais amène à la même réflexion :
- L’État n’est-il source que de contraintes ?
- Est-il possible d’être libre dans l’État ?
Extrait de la dissertation :
L’État est une réalité politique que l’on peut difficilement historiquement dater tant sa formation précède sa théorisation. En Grèce Antique, nous parlions déjà de « société civile » (koinônia politikè) et en Rome Antique de « République » (res publica), mais ce n’est que plus tard, au moment de la Renaissance et surtout en Italie avec Machiavel, que l’État prend le sens moderne que nous lui connaissons, pour seulement finir par s’imposer au milieu du XIXème siècle. La notion d’État est donc une notion évolutive et difficilement appréhensible. On pense généralement que l’État est le garant de notre protection et qu’il nous permet de vivre de manière sécurisée, et en harmonie avec les autres.
[...]
Finalement, nous pouvons penser que l’existence même de l’État provient des hommes et de leur volonté d’être libres : pour qu’un État existe et soit pérenne, il faut avant tout que les citoyens s’y soumettent. Rappelons de même que l’État peut correspondre, du point de vue sociologique, à l’ensemble des personnes d’un même territoire et gouvernées par le même gouvernement. Dès lors, il semblerait paradoxal et même contradictoire de penser que l’État puisse être l’ennemi de la liberté. L’État se comprend en effet à partir de la notion de contrat social, qui est le respect des individus entre eux et donc, ipso facto, des lois.
[...]
Finalement, nous voyons qu’il est possible de réconcilier les deux notions de liberté et d’État. Elles ne s’excluent pas systématiquement et font même corps. Nous pouvons penser la soumission à un pouvoir comme étant l’instance la plus libératrice qui soit. À ce titre, nous pouvons prendre comme exemple la dialectique du maître et de l’esclave du philosophe allemand Hegel. Dans ce concept hégélien tiré de la Phénoménologie de l’esprit, l’esclave travaille et le maître donne les ordres. On pourrait donc penser que de ces deux personnes, le maître est le plus libre. Néanmoins, un renversement dialectique apparaît : par le travail, l’esclave acquiert une liberté d’esprit et donc devient indépendant (« Arbeit macht frei », « le travail rend libre »), au contraire, le maître a besoin de son esclave pour réaliser ses désirs et devient dépendant de lui.
Sommaire du document :
Explications sur le sujet :
- Notion en jeu
- Analyse du sujet
- Enjeux du sujet
- Présupposés
Plan de la dissertation :
Introduction
I) A priori, la soumission à un État et la liberté s’excluent mutuellement
A. État et liberté : des antinomies
B. Soumission aux lois et absence de libre arbitre
C. Supprimer l’État : une approche marxiste
II) Néanmoins, nous pouvons voir en l’État une puissance gardienne et responsable des libertés humaines, qu’elles soient individuelles ou collectives
A. L’État protecteur des hommes, et par extension de la liberté
B. Le bon fonctionnement de la vie libre nécessite l’État : régulation des pulsions naturelles premières de l’homme par la gouvernance du peuple
C. Soumission volontaire de l’homme à l’État
III) La présence d’une institution souveraine est le moteur de la liberté
A. « Nous n’avons jamais été aussi libres que sous l’occupation allemande » - Sartre B. Droit de révolte et liberté
C. Réconcilier liberté et État : dialectique du maître et de l’esclave chez Hegel
Conclusion
FAQs
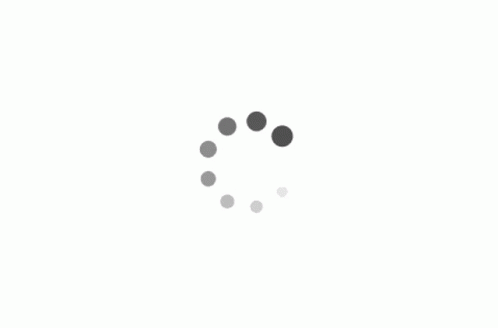
Liste des avis
Aucun avis client pour le moment
Derniers documents dans la catégorie
N’exprime-t-on que ce dont on a conscience ? Corrigé dissertation
Corrigé d'une dissertation de philosophie de plus de 5 pages sur le thème de l'Inconscient et de l'expression. Corrigé entièrement rédigé avec un plan en ...



Faut-il se méfier de ceux qui pensent détenir la vérité ? Corrigé dissertation
Dissertation de philosophie entièrement rédigée dont le sujet est Faut-il se méfier de ceux qui pensent détenir la vérité ? Corrigé avec un plan en 3 pa ...



Peut-on rire de tout ? Corrigé dissertation
Dissertation de philosophie avec un plan en 3 partie qui répond au sujet suivant : Peut-on rire de tout ? Dissertation entièrement rédigée à télécharger ...



Travailler moins est-ce vivre mieux ? Corriger dissertation
Exemple de corrigé d'une dissertation de philo dont le sujet Travailler moins est-ce vivre mieux ? Dissertation à télécharger au format pdf, word et odt. ...



Les machines nous libèrent-elles du travail ? Corrigé dissertation
Corrigé de dissertation entièrement rédigée dont le sujet est : les machines nous libèrent-elles du travail ? Dissertation à télécharger en pdf, word et ...



Le savoir exclut-il toute forme de croyance ? Corrigé dissertation
Corrigé d'une dissertation de philo dont la problématique est Le savoir exclut-il toute forme de croyance ? Dissertation avec plan en 3 parties à télécharg ...


